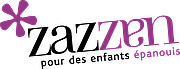Pédagogie active > 6 - 12 ans |
le pouvoir de la musique chez l'enfant
Article du 15 octobre 2016
La musique comme outil de communication
Dès la 28ème semaine de grossesse, le fœtus développe son ouïe et perçoit de manière vibratoire et rythmée les bruits du corps de sa mère: son rythme cardiaque, sa voix... il vit déjà au rythme d'une mélodie humaine proche d'un air de percussion.
Après sa naissance, le tout-petit absorbe le monde qui l'entoure ; les expériences musicales et sonores qu'il vit entraînent de multiples connexions neuronales. Ses premières productions sonores passent par les cris: le cri de la faim auquel sa mère répond par des mots ; la relation s’établit.
La musique facilite la communication et participe ainsi à la création du langage.
L'enfant va rapidement être créateur de sons: chaque élément de sa vie quotidienne devient alors source de création sonore: une cuillère qui tape dans l'assiette, une petite voiture cognée contre la fenêtre... Quand il crée des sons, l'enfant exerce la partie de son cerveau qui traite la pensée proportionnelle: il s'ajuste, il jauge et affine sa perception auditive.
Plus tard la musique ouvre une nouvelle forme de communication en créant des liens universels: on ne parle pas la même langue mais un son peut permettre de se comprendre. La musique et les sons sont les fondements d'une communication humaine.
La musique comme aide au développement émotionnel
La musique est étroitement liée à nos émotions. Chez le tout-petit, le son d'une voix se traduit par des réactions physiques perceptibles.
Plus tard, l'écoute d'une mélodie peut selon notre émotionnel de l'instant nous envahir de joie ou au contraire nous bouleverser. Vers 10-12 ans, l'enfant peut se reconnaître dans certains textes ou mélodies qui imagent son quotidien et ses ressentis. La musique, dès le plus jeune âge, peut donc être utilisée comme un outil permettant d'associer une émotion à un son afin d’en mieux saisir la puissance.
Pour l’adolescent, l'affichage des goûts musicaux devient un vecteur d'expression de soi, de son identité. Il va alors jouer le double jeu de la conformité, pour s'intégrer, et de l'originalité, pour se démarquer. La musique lui sert aussi à briser les solitudes ; le face-à-face avec soi-même peut être générateur d'angoisse. Ce besoin de stocker d’innombrables titres sur son ordinateur peut être pour lui une manière inconsciente de se prémunir contre une éventuelle pénurie.
Il n'est pas rare que la musique soit utilisée pour panser les blessures physiques et surtout psychiques. Cette idée que la musique a un pouvoir guérisseur ne date pas d'aujourd'hui et se retrouve dans toutes les cultures, bien qu’on semble redécouvrir actuellement son pouvoir thérapeutique: musique d’ambiance pour médecines douces, orchestre de malades…
Quelle musique à quel âge?
Il est bien difficile d'établir un tableau répondant précisément à cette question! La musique se vit différemment d'un être humain à l'autre.
Après la naissance, qui représente un formidable bouleversement pour l'enfant, il est capital de lui offrir des sons sécurisants, que son inconscient reconnaît et associe au bien être: des musiques à percussions fortes lui permettront de se remémorer les battements du cœur de sa maman lorsqu’il était encore en elle.
Puis viendront les comptines d’une importance considérable sur le plan relationnel puisqu’elles sont source de plaisir partagé par l’enfant et l’adulte. Pour l’enfant, elles jouent un rôle essentiel dans les processus de transmission et d’apprentissage. Pour les adultes, elles apparaissent comme le résultat d’une adaptation spontanée et intuitive aux besoins de l’enfant. En lui amenant une dimension émotionnelle, la musique va être présente dans les rituels de vie de l’enfant et lui apporter une source d'apaisement comme la petite chanson du soir avant l’extinction de la lumière.
Plus tard, associer le rythme aux mouvements du corps aide l'enfant à acquérir ses premières notions spatio-temporelles: il va lier des sensations éparses et les réassembler mentalement pour ensuite les traduire corporellement. Par exemple, une musique très rythmée engendre un besoin de bouger, sauter, marquer le temps. La musique peut susciter la peur si elle est l'écho d'un mécanisme de défense contre une menace objective pour sa sécurité - le cri d'un animal ou le bruit de la tempête. En revanche, une musique agréable peut être liée au souvenir de sons et de bruits favorables, comme des occasions de socialisation à l’occasion de fêtes familiales, de rencontres…
L'essentiel est donc toujours l'observation de l'enfant ou de l’adolescent et de son état émotionnel, qui va permettre la bonne association musicale au juste moment.
La musique se vit, de façon quotidienne et sous toutes ses formes diverses aussi simples que complexes, en ayant pourtant la même finalité: «se garantir un quart de bonheur» (Jules Renard).
Anne-Sophie Chaunu, Conseillère en pédagogie et Educatrice de jeunes enfants